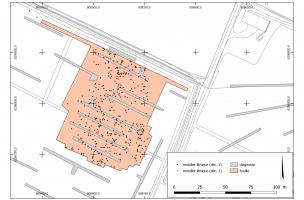Vous êtes ici
La Costière de Nîmes, occupée dès le Paléolithique ancien, la plus ancienne période de la Préhistoire
Préalablement à la construction du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier, Oc’Via Construction a confié à l’Inrap l’ensemble des fouilles préventives prescrites par l’État (Drac Languedoc-Roussillon) sur le tracé de la future ligne à grande vitesse. C’est au Mas de Vouland qu’une équipe d’archéologues achève actuellement une fouille d’une durée de 3 mois, au sud de la commune de Nîmes. Elle a permis de recueillir un ensemble d’objets de pierre taillée, qui ont été piégés sur le site par l’action de phénomènes naturels.
La découverte est exceptionnelle à plus d’un titre. Ces objets, par leur nombre et leur homogénéité, offrent une documentation sans équivalent sur la présence des hommes dans la Costière de Nîmes dès le Paléolithique ancien, la plus ancienne période de la Préhistoire. En outre, cette période a été le plus souvent étudiée grâce à des vestiges découverts dans des grottes, mais beaucoup moins observée dans des contextes de plaine, comme c’est le cas ici.
Des objets conservés dans le sol depuis les premiers temps de la Préhistoire
C’est un véritable gisement d’outils préhistoriques que les archéologues ont mis au
jour sur une superficie de 8 000 m² jouxtant le Mas de Vouland : des objets de
pierre taillée, attestant la présence de groupes de chasseurs-cueilleurs du
Paléolithique ancien.
Compte tenu de la faible densité des vestiges (en moyenne 4 objets tous les
100 m²), une fouille manuelle traditionnelle était exclue : les chercheurs ont donc
utilisé des pelles mécaniques pour procéder à la fouille, explorant le terrain par
décapages successifs d’une dizaine de centimètres d’épaisseur. Tous les cailloux
exhumés sont examinés et ceux présentant des traces de modification humaine sont
recueillis pour étude. Leur emplacement d’origine est enregistré précisément à
l’aide d’un tachéomètre laser qui permet par la suite de restituer une cartographie
fidèle du site à l’issue de la fouille.
La Costière de Nîmes, occupée dès 600 000 à 300 000 ans avant le présent
Plus de 330 objets ont ainsi été découverts depuis le début de la fouille, en majorité des galets aménagés et des pics. Ces outils ont été sommairement taillés, à partir
des galets de quartzite de la Costière, déposés là par le Rhône qui, il y a plusieurs
centaines de milliers d’années, empruntait le cours de la Vistrenque. Quelques
petits éclats de silex sont également présents, dont un retouché en racloir. Les
ossements des animaux chassés par les occupants préhistoriques des lieux ne se
sont malheureusement pas conservés.
Les archéologues ont également dégagé un biface en quartzite. Si des vestiges
similaires ont pu être recueillis dans le secteur dans les années 1970, ils l’avaient
été fortuitement, en surface des sols, suite aux remaniements agricoles. Ici, pour la
première fois, la mise au jour de ce biface dans un contexte de fouille permet
d’évaluer approximativement l’âge de l’industrie lithique, par comparaison avec
des objets provenant de sites datés avec précision. Les outils découverts ici
évoquent l’Acheuléen, une culture connue en Europe occidentale entre environ
600 000 et 300 000 ans avant le présent. Cependant, ils ne pourront sans doute pas
être datés avec plus de précision car ils n’ont pas été conservés dans leur contexte
sédimentaire originel. Des phénomènes naturels de grande ampleur survenus au gré
des alternances de phases glaciaires et de périodes interglaciaires, jusqu’au dernier
radoucissement climatique lié à la fin de la dernière glaciation, il y a environ
12 000 ans de cela, les ont déplacés et redéposés.
La fouille du Mas de Vouland est donc l’occasion de renouveler profondément les
connaissances concernant la Préhistoire ancienne de la région et offre un matériau
de recherche inédit pour comprendre les relations des groupes ayant occupé le
secteur au Paléolithique ancien, probablement des Homo heidelbergensis,
contemporains voire cousins de ceux ayant vécu dans la Caune de l’Arago à
Tautavel.

Mas de Vouland, Nîmes (Gard), 2013.
Vue générale de la fouille.
L’exploration par décapages successifs à la pelle mécanique d’une vaste dépression argileuse au sein des niveaux de galets de la Costière nîmoise a permis de recueillir près de 500 objets de pierre taillée.
© Vincent Mourre, Inrap 2013.

Mas de Vouland, Nîmes (Gard), 2013.
Gros galet taillé en quartzite.
Le traitement du mobilier archéologique (lavage, marquage à l’encre de Chine) a pu être réalisé sur place, dès la phase de terrain.
© Vincent Mourre, Inrap 2013.
Aménagement : Oc’Via
Contrôle scientifique : Service régional de l’Archéologie (Drac Languedoc-Roussillon)
Recherche archéologique : Inrap
Responsable scientifique : Vincent Mourre, Inrap