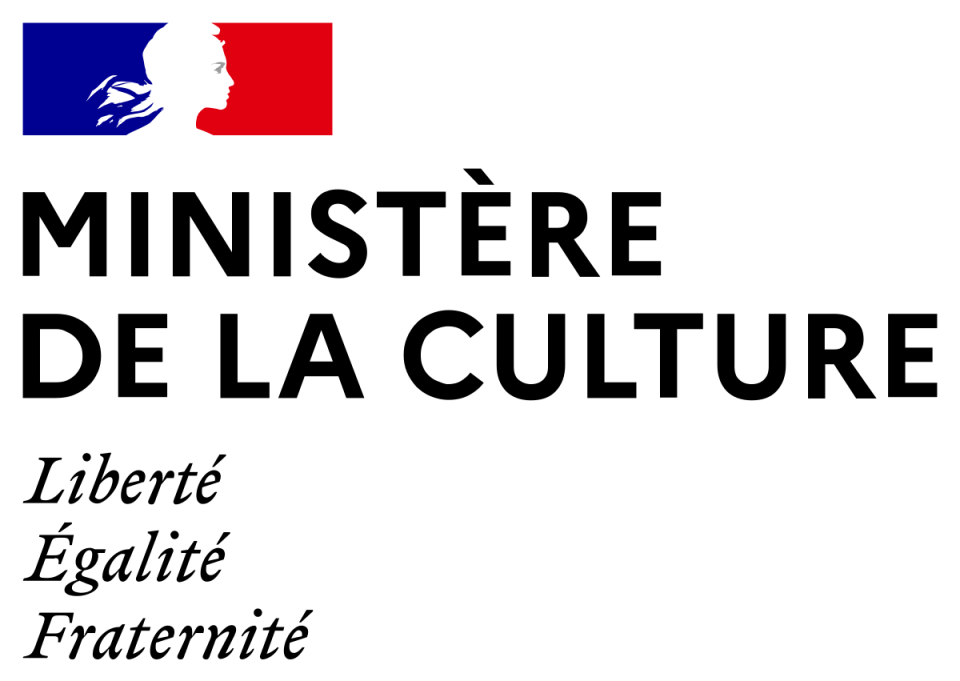Vous êtes ici

Une nécropole antique et mérovingienne remarquable dans la plaine de Caen à Evrecy
Porteur du projet : Thomann Aminte (Inrap Grand-Ouest, UMR 6273 Craham)
Participants : Yves-Marie Adrian (Inrap, UMR 7041 ArScAn), Anne claire Angeli (MADE), Céline Bemilli (Inrap, UMR 7209 BioArch), Erwan Bourhis (Inrap), Vincent Carpentier (Inrap, UMR 6273 CRAHAM), Hélène Delnef (Inrap), Olivier Dutour (EPHE, UMR 6034 Archéosciences Bordeaux), Lénaïg Ferret (Inrap), Magalie Guerit (Inrap, UMR 5138 ArAr), Bernard Gratuze (UMR 5060 IRAMAT), Michel Kaspzryk (Inrap, UMR 6298 ArTeHiS), Serge Le Maho (Inrap), Ugo Le Moigne (Inrap), Cyril Marcigny (Inrap, UMR 6566 CReAAH), Léïa Mion (School of History Archaeology and Religion, Cardiff University, Cardiff, United Kingdom), Fabien Pilon (UMR 7041 ArScAn), Marie-Cécile, Truc (Inrap, UMR 6273 CRAHAM)
En 2014, à Evrecy, une nécropole antique et mérovingienne complète a été fouillée. Un quart des 377 sépultures renfermait des objets associés au défunt, dont certains sont des pièces exceptionnelles datées du début du Ve s. L’étude de ce mobilier, associée aux études anthropologiques, a permis de témoigner de la présence, sans doute au sein d’une population locale modeste, d’une petite élite d’origine gallo-romaine et une élite militaire « romano-germanique » à la fin de l’Antiquité.
La découverte inédite d’une nécropole remarquable
En 2013, à Evrecy, a été découverte en diagnostic une nécropole antique et mérovingienne non répertoriée et remarquable à plus d’un titre. Fouillé en 2014, le site a révélé la présence de 377 sépultures constituant une nécropole complète (fig. 1). S’installant au cours du IVe siècle sur un réseau de fossés d’enclos et une occupation probablement artisanale datés des IIe-IIIe siècles, cette zone funéraire perdure jusqu’à la deuxième partie du VIIe siècle. Ce sont les tombes de l’Antiquité tardive qui sont les plus riches en mobilier : céramiques, verreries, monnaies, tabletterie et objets métalliques, dont certaines pièces exceptionnelles.
Grâce à l’abondant mobilier préservé dans 132 tombes, l’étude de ce site permet d’enrichir considérablement nos connaissances sur la composition de la population ayant vécu dans ce secteur de la plaine de Caen. Hormis l’intérêt patrimonial de la découverte inédite de ces tombes riches en mobilier, l’étude de ce corpus nous indique que sont inhumés au même moment dans cette nécropole, sans doute au sein d’une population locale modeste, une petite élite d’origine gallo-romaine et une élite militaire probablement d’origine « romano-barbare ».

1. La nécropole d’Évrecy en cours de fouille. À ce stade, une grande partie des tombes au sud-ouest du cimetière est déjà fouillée.
Cliché : Arnaud Poirier
À l’époque antique
Entre le milieu du IVe siècle et le milieu du Ve siècle, 65 sépultures renferment du mobilier antique, principalement de la vaisselle généralement observée dans la région mais en proportion plus grande. Parmi elles, huit sépultures livrent des dépôts que l’on peut considérer comme appartenant à une élite de tradition gallo-romaine (fig. 2).
L’instrumentum a également permis l’observation d’un groupe de sept sépultures où la nature des dépôts paraît distincte de ceux de tradition gallo-romaine, et évoquent des traditions funéraires germaniques (fig. 3). Parmi elles, un sépulture (fig. 4) présente une paire de fibules en « tutulus », connues dans le barbaricum depuis le IIIe siècle. Ces sépultures apparaissent durant la deuxième période, à savoir la toute fin du IVe siècle, et perdurent jusqu’à la fin du premier tiers du Ve siècle.
Les tombes masculines ne livrent pas de mobilier germanique ; toutefois, la présence d’armes (fig. 5), mais aussi de ceinturons (fig. 6) et de siliques, indique que les défunts appartenaient sans doute à la militia de l’Antiquité tardive.
L’étude paléopathologique des restes osseux offre des informations complémentaires. En effet, les défunts de certaines de ces tombes sont morts suite à des violences interpersonnelles (un coup au crâne avec un objet contondant et un coup de hache sur le crâne). De même, quatre défunts accompagnés soit d’un ceinturon, soit d’armes, présentent plusieurs traumatismes osseux, récents et plus anciens. Ce nombre important de traumatismes et, parfois, leur fréquence dans le temps, est peu probablement imputable à des accidents de la vie quotidienne, et plus probablement à des activités de combats. Il est ainsi possible d’évoquer une activité guerrière pour certains défunts de ce groupe d’inhumés avec du mobilier d’accompagnement de type militaire, et parfois aussi, une mort au combat.

2. La sépulture 681 avec son mobilier d’accompagnement de tradition gallo-romaine.
Cliché : Philippe Gilette, Inrap

3. Mobilier d’accompagnement de la sépulture d’une adolescente datée du premier tiers du Ve siècle, mêlant mobilier de tradition locale, mais aussi des pièces plus rares et des éléments du costume funéraire germanique.
Cliché : Serge Le Maho, Inrap

4. Détail d’une sépulture datée entre 370 et 420 ap. J.-C. où la défunte porte un costume attaché par des fibules en « tutulus » ou de trompette, probablement de production gauloise mais destinées à une clientèle d’origine germanique.
Cliché : Aminte Thomann, Inrap
À l’époque mérovingienne
À la fin de l’Antiquité, la nécropole est utilisée de manière continue aux VIe et VIIe siècles. Dans les tombes, les dépôts sont plus simples. Constitués essentiellement de boucles d’oreille et d’éléments de ceinture en fer ou bronze (fig. 7), ces dépôts semblent caractéristiques d’une population mérovingienne formant une petite communauté villageoise ordinaire. La présence d’une plaque-boucle d’origine wisigothique dans une tombe féminine pose la question de l’origine étrangère de la défunte. Toutefois, l’analyse anthropologique de cet individu et du groupe mérovingien confirme une homogénéité morphologique, indiquant d’avantage l’importation de cet objet et l’origine locale de la défunte.

7. Plaque-boucle triangulaire à dix bossettes en bronze ornée d’un décor natté. Initialement, la surface était recouverte d’étain, conférant à l’objet, l'aspect blanc et brillant de l’argent. La cassure a été consolidée au moyen d'une plaque en fer rivetée au revers de l’objet (VIIe siècle).
Cliché : Serge Le Maho, Inrap
Pour la publication, l’apport d’un programme de datations et des analyses isotopiques
Grâce à un programme de datations C14 financées par le programme Artémis, 54 datations ont été menées afin de confirmer certaines hypothèses de datation émises lors du rapport, d’agrandir l’échantillon des sépultures calées chronologiquement et de mieux comprendre l’évolution spatiale de l’occupation cémetériale antique et mérovingienne.
Les résultats ont mis en évidence deux datations surprenantes de l’âge du Bronze pour deux individus.
Ces éléments, associés aux données stratigraphiques, funéraires (comme par exemple l’orientation des tombes) et du mobilier, sont actuellement intégrés dans une approche de la chronométrie des phases établies par le biais des statistiques bayésiennes. Cette méthode permettra à court terme de dater plus de tombes sans mobilier.
Pour le projet de monographie, une étude a en outre été menée par Léïa Mion sur 66 échantillons humains et 31 échantillons de faune en vue de leur analyse isotopique du carbone, de l’azote, du soufre, de l’oxygène et du strontium. Financée par le ministère de la Culture et le département du Calvados et supervisée par le laboratoire du LAMPEA, cette étude a permis de compléter les résultats de la fouille et d’aider à la compréhension de l’origine exogène ou non des élites de l’antiquité tardive. L’analyse du carbone, de l'azote et du soufre des animaux du site montre un approvisionnement en ressources carnées qui est majoritairement local mais provenant d’environnements variés. Les résultats des analyses du strontium des humains montrent une évolution des pratiques de mobilités au cours du temps avec des individus plus souvent exogènes pendant la période antique. Mais la majorité des individus analysés ont probablement vécu dans la plaine de Caen avant leur mort d'après les données de soufre. L'alimentation est globalement la même entre les deux périodes mais les conditions d'accès aux ressources semblent être différentes avec une plus grande variabilité des données isotopiques du carbone à la période antique comparée à la période mérovingienne. Enfin la comparaison avec les données contemporaines de la plaine de Caen semble pointer vers un patron de mobilité et d’alimentation propre à Evrecy.
- Porte Folio Inrap (2018) : Le verre en contexte archéologique : l’exemple de la nécropole d’Evrecy (Calvados).
- Vidéo de la fouille (2014) : Une nécropole mérovingienne complète dans le Calvados.
- La nécropole tardo-antique d’Evrecy (Saint-Aubin des Champs 2, Calvados). Antiquité tardive en Gaule. Consulté le 4 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/d20p