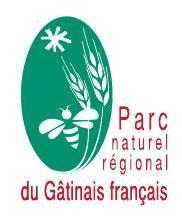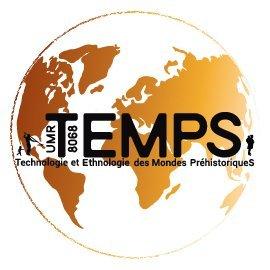Vous êtes ici

Art rupestre préhistorique dans les chaos gréseux du Bassin parisien. Étude, archivage et valorisation (ARBap)
Porteur du projet : Boris Valentin
Coordinateur Inrap : Régis Touquet
Participants : Alain Bénard (Amis de la Forêt de Fontainebleau), François Bétard (Sorbonne-Université), Béatrice Bouet (DRAC/SRA Île-de-France), Alexandre Cantin (Université Paris 1, UMR 8068 Temps), Pierre Bouillot (GERSAR), François Bougnères (Summum 3D), Isabelle De Miranda (ArkéoMédia, UMR 8068 Temps), Cynthia Domenech-Jaulneau (DRAC/SRA Île-de-France), Patrick Dubreucq (Amis de la Forêt de Fontainebleau), Colas Guéret (CNRS, UMR 8068 Temps), Rosalie Jallot (Inrap), Jean-Yves Lacroix (GERSAR), Émilie Lesvignes (UMR 8068 Temps), Nathalie Le Tellier-Becquart (UMR 8068 Temps), Florence Mousset (DRAC/SRA Île-de-France), Cécile Olivier (Inrap), Michel Rey (GERSAR), Éric Robert (MNHN, UMR 7194 HNHP), Thomas Sagory (Ministère de la Culture, Musée d’Archéologie nationale), Bénédicte Souffi (Inrap), Benoit Touchard (Summum 3D), Régis Touquet (Inrap), Laurent Valois (GERSAR), Lisa Veysset (Université Paris 1).
Parmi les innombrables gravures des chaos de grès du sud de l’Île-de-France, très menacées vu la fréquentation touristique de ces zones forestières, un certain nombre peuvent être attribuées au Paléolithique récent et au Mésolithique (-42 000/-7 000 av. J.-C.). Depuis 2017, un projet collectif de recherches s’y intéresse, réunissant une vingtaine de chercheurs et notamment plusieurs membres d’une association très active de bénévoles.

Abri gravé dans les chaos gréseux du Bassin parisien (éclairage LED).
E. Lesvignes, PCR ARBap, 2017
Les objectifs du projet
Dans les chaos de grès entre Nemours et Rambouillet, sur 1 800 km2, on connaît environ 2 800 cavités qui ont été gravées à diverses époques jusqu’à nos jours. La plupart ont été découvertes grâce aux prospections d’une association de bénévoles très active, le Groupe d’Étude de Recherches et de Sauvegarde de l’Art Rupestre (GERSAR). Il existe au moins une œuvre paléolithique aussi ancienne que Lascaux (ca – 21 000 av. J.-C.) et il existe surtout des milliers de gravures géométriques, dont plusieurs remontent sans doute aux alentours de -10 000 av. J.-C., à la fin du premier Mésolithique.

Gravures géométriques remontant sans doute au Mésolithique (lumière naturelle).
E. Lesvignes, PCR ARBap, 2024
La DRAC Île-de-France a lancé en 2017 un programme collectif de recherche (PCR) fédérant les actions d'une vingtaine de chercheurs institutionnels et bénévoles sur ces gravures préhistoriques. Ce programme est soutenu par l’Inrap depuis 2023 par l'attribution de jours de recherche à ses collaborateurs. Il s’appuie sur des relevés d'art rupestre, des études approfondies du contexte géologique, des prospections ainsi que des fouilles dans un des abris, dans le cadre d’une opération programmée spécifique. Ces travaux ont pour ambition d’approfondir la connaissance des rituels paléolithiques et mésolithiques et de préciser leur datation. Des analyses spatiales à divers niveaux décryptent les choix préhistoriques (quel type de grès et de cavité ? quelle répartition pour les principaux motifs ?...). Une abondante iconographie (en 2D et 3D) est constituée et archivée, contribuant à une documentation approfondie sur ce patrimoine très exposé à une intense fréquentation touristique. En partenariat avec le Parc naturel régional du Gâtinais français et l'Office National des Forêts, le PCR développe avec l’association ArkéoMédia un programme de valorisation et de sensibilisation afin que chacun — en particulier riverain — devienne protecteur de ce patrimoine très fragile. Cette mise en valeur prend place dans un projet francilien plus vaste de développement touristique et culturel porté par la DRAC : « Dans les pas des derniers chasseurs… ».
Principaux résultats
Nous nous sommes beaucoup intéressés à deux des rares abris comportant des gravures de style paléolithique. Dans une cavité à Buno-Bonnevaux (91), encore en cours d’étude, un aurochs au style probablement anté-magdalénien coexiste avec des motifs géométriques : nous vérifions si ces derniers sont bien postérieurs, ce que suggère la parenté de ces motifs avec le répertoire attribué au Mésolithique (cf. infra). L’autre abri paléolithique, à Noisy-sur-École (77), comporte un cheval dont le style évoque la grotte de Lascaux, ainsi qu’un autre très érodé, tous les deux encadrant un pubis féminin sculpté d’où s’écoule de l’eau en cas de fortes pluies.

Abri orné de Noisy-sur-École (77), dans lequel figurent deux chevaux gravés encadrant un pubis sculpté (éclairage LED).
E. Lesvignes, PCR ARBap, 2018
Des recherches approfondies ont porté également sur deux abris mitoyens, ornés semble-t-il pendant le Mésolithique : nous y avons minutieusement caractérisé une catégorie de motifs emblématiques : des quadrillages, dont nous avons pu évaluer la facilité et le temps bref de réalisation, en référence à des reproductions expérimentales. Par ailleurs, nous avons commencé à rechercher des arguments permettant de confirmer l’attribution de ces quadrillages, ainsi que d’autres motifs, tels que des sillons parallèles larges et profonds, aux derniers chasseurs-cueilleurs de la région. Les datations sur calcite ont échoué pour le moment, et nous nous sommes tournés vers la Grotte à la Peinture à Larchant (77), l’un des sites livrant des niveaux mésolithiques riches en objets en silex — en particulier quelques marqueurs chronologiques — recyclés en « gravoirs » ayant incisé le grès. Un nouveau programme de fouille a démarré en 2020, et un volumineux fragment de paroi gravée, découvert autrefois dans un niveau mésolithique, a été réexhumé. Sur ce site également, une collaboration avec l’université de Madrid a permis d’étudier une des rares peintures conservées dans la région et de la rapprocher d’un autre ensemble peint à Fontainebleau (77), lequel comporte des cervidés présentant des analogies avec l’art du Levant espagnol.
Travaux en cours
Nos recherches actuelles suivent deux axes principaux, chronologique et géographique. Les résultats des travaux à la Grotte à la Peinture seront inclus dans un répertoire que nous publierons à propos d’une dizaine d’autres abris ornés, qui ont été fouillés entre les années 1950 et 1980, livrant alors des couches des alentours de -10 000 av. J.-C., riches en gravoirs. L’examen attentif des parois de ces abris permet de définir un registre de motifs attribuable à cette époque mésolithique, lequel se retrouve dans beaucoup d’autres abris disséminés dans toute la zone des grès du sud de l’Île-de-France. Dans quelques cavités, qui se sont fracturées après sous-tirage par l’érosion des sables encaissants, des parois ornées ont elles-mêmes été cassées. Nous espérons pouvoir dater certaines fractures, et ainsi fixer des terminus ante quem aux gravures, grâce à des datations par nucléides cosmogéniques (cf. béryllium-10).
Dans cette zone des grès, deux secteurs-tests ont été délimités, l’un sur la commune de Larchant, l’autre en haute-vallée de l’Essonne. Dans ces secteurs, nous examinons la distribution des abris gravés afin de déterminer les critères préhistoriques ayant conduit au choix des cavités ornées. Nous nous intéressons également à la répartition différentielle de certains motifs attribués à l’époque des derniers chasseurs-cueilleurs (quadrillages versus sillons larges et profonds), laquelle pourrait résulter d’un échelonnement chronologique durant le Mésolithique.
Pour analyser en détail ces répartitions, il est nécessaire de s’assurer que le résultat des prospections intensives n’est pas trop biaisé. À cet effet, nous cherchons à mesurer l’impact des destructions liées aux carrières modernes et nous nous apprêtons également à évaluer l’ampleur des zones de bas de versant dans lesquelles des abris pourraient encore être masqués par des colluvions.
Partenariat avec l’Inrap
Pour l’étude approfondie de quelques abris, nous utilisons diverses méthodes de relevé, dont certaines font appel à la photogrammétrie. Les modèles numériques complets dont nous disposons pour une vingtaine de cavités ont été géoréférencés par Régis Touquet. En outre, il a entrepris de numériser lui-même quelques vestiges des carrières modernes (fronts et abris) auxquelles nous nous intéressons indirectement (cf. supra), car ces vestiges constituent des objets patrimoniaux aisément valorisables.

Régis Touquet (Inrap) au cours de l’enregistrement topographique d’un abri (éclairage LED).
E. Lesvignes, PCR ARBap, 2017
En outre, pour les diverses approches spatiales que nous développons, un SIG a été constitué qui intègre les données du GERSAR versées à la carte archéologique. Régis Touquet en assure la maintenance et la mise à disposition pour tous les collaborateurs, contribuant par ailleurs aux réflexions en cours à propos d’une future base de données relationnelles destinée à articuler données spatiales et iconographiques.
En complément des recherches liées au PCR, le partenariat de l'Inrap permet parfois d'explorer, comme nous l’avons signalé pour les carrières, des voies parallèles concernant des patrimoines archéologiques plus récents. Il permet, notamment, à Rosalie Jallot d’épauler Michel Rey (GERSAR) pour des prospections pédestres dans le secteur de la vallée de l’École (77), suite au premier repérage d’un nombre important de monuments mégalithiques (menhirs isolés ou groupés, monuments funéraires et polissoirs).
- Rochers ornés d’Île-de-France : https://archeologie.culture.gouv.fr/fr/rochers-ornes-dile-de-france
- Rocher du Duc à Champcueil : https://www.art-rupestre-pnr-gatinais.fr/in_01.htm