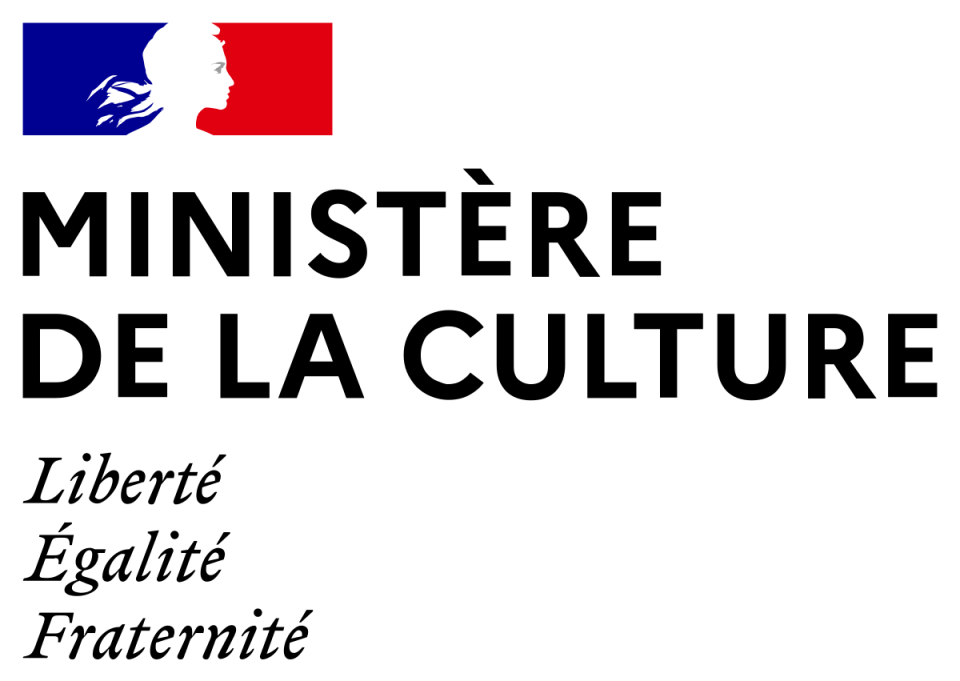Vous êtes ici

Le jubé de Notre-Dame de Paris : nouvelles découvertes
Porteur du projet : Christophe Besnier
Participants : Pierre Arese (CNRS), Aurélia Azema (LRMH), Elise Baillieul (Université de Lille), Laetitia Barague-Zouita (C2RMF), Mathilde Bernard (CEA), Damien Berné (Musée de Cluny), Christophe Besnier (Inrap), Dorothée Chaoui-Derieux (DRAC/SRA Île-de-France), Hélène Civalleri (Inrap), Florent Comte (CNRS), Livio de Luca (CNRS), Angèle Dequier (LRMH), Stéphane Deschamps (DRAC/SRA Île-de-France), Marie-Hélène Didier (CRMH), Stéphanie Duchêne (LRMH), Jennifer Feltman (Université d'Alabama), Mathilde Ferrari (Inrap), Yves Gallet (Université Bordeaux Montaigne, GT Pierre), Alexandra Gérard (C2RMF), Axelle Janiak (Université Paris I), Iliana Kazarska (Université Catholique de Paris), Pierre-Yves le Pogam (Musée du Louvre), Lise Leroux (LRMH), Maxime Lheritier (Université Paris 8), Olivier Malavergne (LRMH), Azzura Palazzo (C2RMF), Anthony Pamart (CNRS), Roxane Roussel (CNRS), Dany Sandron (Université Paris IV, GT Décor), Annabelle Sansalonne (ASCR), Hélène Susini (C2RMF), Jonathan Truillet (EPRND), Philippe Villeneuve (ACMH), Nicolas Warmé (Inrap).
Ce projet collectif de recherche a pour objectif d’étudier, numériser, diffuser et publier le corpus exceptionnel de plus de 1000 fragments de sculptures du XIIIe s. appartenant au jubé médiéval de Notre-Dame de Paris et découvert lors des fouilles préventives de 2022.
En 2022, une opération de fouille a été menée par l’Inrap au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à la croisée du transept. Cette fouille a permis de mettre au jour 1035 fragments de sculptures médiévales, dont plus de 700 sont d’une éclatante polychromie.
Jusqu’à présent, seule une trentaine d’éléments de ce jubé étaient connus : huit sont exposés au Louvre, dont « Adam et Eve et la chaudière de l’Enfer » et une vingtaine conservée dans les réserves lapidaires de Notre-Dame.
Cette découverte est exceptionnelle, tant au niveau du volume du corpus, de la variété des représentations (personnages appartenant à la Passion du Christ, décors architecturaux, animaux réels et légendaires, décors végétaux…), de la conservation de la polychromie sur de nombreux blocs (lapis-lazuli, décor à la feuille d’or…) que de la finesse d’exécution. Cette découverte permet de renouveler considérablement la connaissance du jubé de Notre-Dame et d’apporter une contribution d’envergure à la connaissance de l’art médiéval.
En raison des enjeux scientifiques, patrimoniaux et médiatiques de cette découverte, il est apparu nécessaire de créer un projet collectif de recherche fédérant des chercheurs d’horizons et de spécialités complémentaires afin d’assurer l’étude la plus exhaustive possible du jubé, sa numérisation, la publication de son catalogue et des études, mais aussi d’élargir le corpus aux éléments présents dans d’autres collections, publiques et privées.

Buste du jubé de Notre-Dame de Paris, vers 1220-1230.
Hamid Azmoun, Inrap, 2024